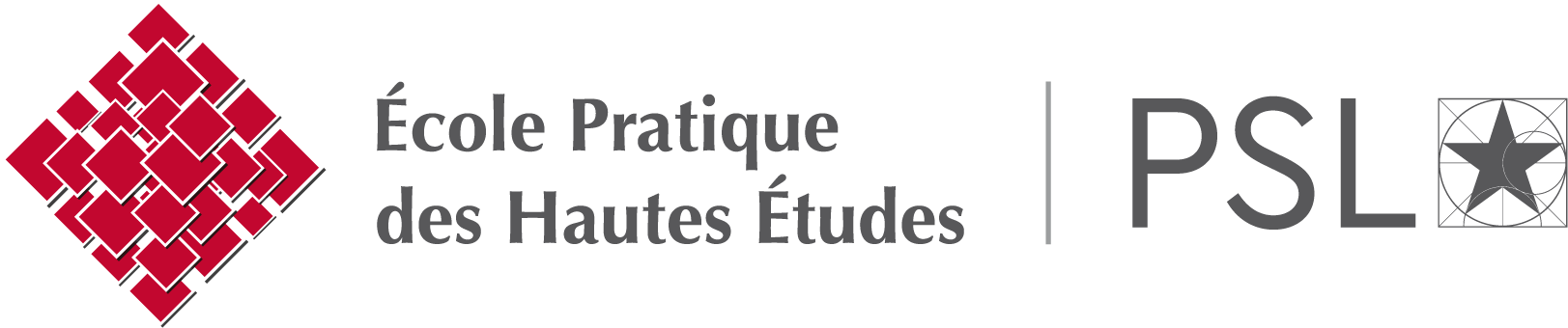Physiopathologie des infections ostéo-articulaires à Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis
Résumé
Staphylococcus aureus et S. epidermidis constituent les principaux agents étiologiques des
infections ostéo-articulaires (IOA), infections sévères, volontiers chroniques et récidivantes.
L’objectif de notre travail était de mieux comprendre la physiopathologie des IOA en
étudiant les interactions entre les staphylocoques et les ostéoblastes (cellules spécialisées
dans l’appositionosseuse) et plus particulièrement, les phénomènes d’internalisation, de
persistance et de transition phénotypique des bactéries intracellulaires.
La première étape de notre travail a consisté à développer et à valider i) un modèle
d’infection cellulaire à S. aureus in vitro (lignée ostéoblastique MG-63) et ii) des techniques
originales permettant de quantifier simultanément la capacité d’adhésion et
d’internalisation des staphylocoques dans les ostéoblastes par cytométrie en flux en
utilisant un antibiotique ciblant la paroi des bactéries Gram positive couplé avec un
fluorochrome.
A l’aide des outils mis en place, nous avons étudié l’impact de la transition phénotypique
des bactéries intracellulaires conduisant à l’expression du phénotype microcolonie ou Small
Colony Variant (SCV), forme adaptée à la survie intracytoplasmique, sur l’interaction
bactéries/ostéoblastes ex vivo en culture cellulaire. Des mutants stables ont été générés in
vitro en invalidant les gènes codant pour la biosynthèse de l’hémine (hemB) ou de la
ménadione (menD). Les résultats obtenus avec un couple de souches isogéniques
(menD/DmenD), indiquent que les taux d’internalisation, d’adhésion, de cytotoxicité et de
sécrétion cytokinique sont plus faibles avec le variant SCV qu’avec la souche sauvage. Ces
résultats qui s’opposent à ceux rapportés par certains auteurs, soulignent la complexité des
interactions hôtes-pathogènes dans les modèles ex vivo, l’influence du modèle cellulaire
utilisé et de la voie métabolique inactivée dans le cas des SCV. Afin de compléter nos
résultats, les mêmes expériences devraient être reproduites avec un couple de souches
isogéniques inactivées pour le gène hemB.
Enfin nous nous sommes intéressés aux IOA sur matériel à S. epidermidis qui sont
aujourd’hui principalement expliquées par l’inoculation bactérienne, lors de la chirurgie,
des souches responsables de portage chez le patient. Or, si le portage de S. epidermidis est
décrit comme universel, les infections sur matériel orthopédique restent peu fréquentes. Les
souches de S. epidermidis responsables d’IOA pourraient donc représenter une souspopulation
particulière au sein des souches de portage, présentant des facteurs de virulence
particuliers favorisant l’apparition d’une IOA. La mesure des niveaux d’adhésion et
d’internalisation de souches de S. epidermidis issues de portage nasal et d’IOA sur matériel
n’a pas permis de distinguer les deux populations étudiées suggérant que i) les souches de S
epidermidis constitue une seule population Homogène, ii) les souches de S. epidermidis sont
accidentels. Nos résultats démontrent également que les souches de S. epidermidis
présentent une capacité d’adhésion et d’invasion nettement plus faible que les souches de S.
aureus, suggérant que l’internalisation au sein des ostéoblastes joue probbalementun rôle
moins important dans la physiopathologie des IOA à S. epidermidis que dans les IOA à S.
aureus. La capacité de formation de biofilm, élément essentiel dans la chronicisation des
IOA sur matériel à S. epidermidis, mériterait d’être explorée et pourrait être un facteur plus
discriminant pour distinguer les souches invasives parmi les souches de portage.
Loading...