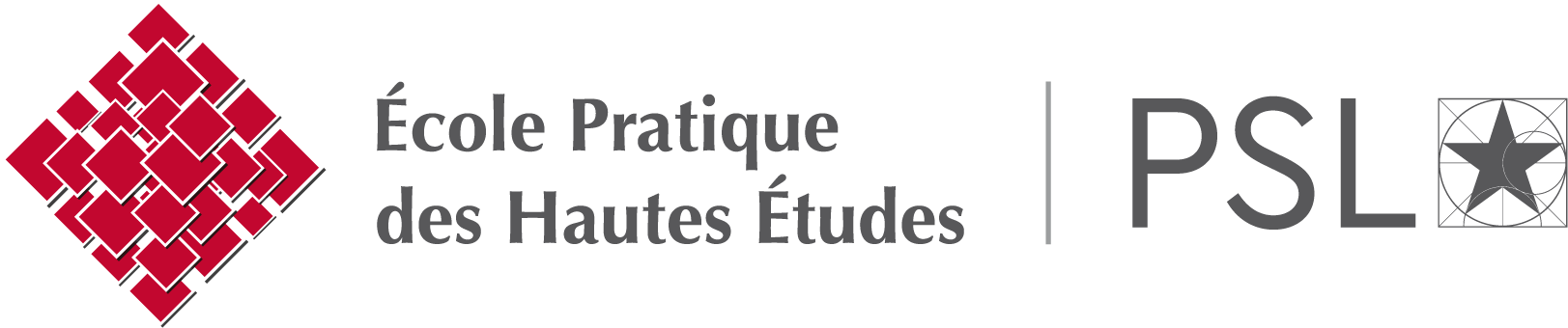Le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) sur l’île de Béniguet (Finistère)
Résumé
La colonie de cormorans huppés (
Phalacrocorax aristotelis
) a fait l’objet d’un suivi sur l’île de
Béniguet (mer d’Iroise) depuis 1992. Sur 21 ans, les
sites actifs y sont passés de 3 en 1992 à 166 en 2012,
avec un maximum de 210 en 2010. Cela
représente un taux de croissa
nce annuel moyen de 1.21 sur 21
ans.
Depuis 2006, la production de pou
ssins par site de reproduction
a été évaluée. Elle a fortement
varié entre 2006 et 2012, avec un minimum en 2007. La pr
obabilité de succès sur un site varie selon les
caractéristiques des sites. La probabilité qu’un site soit
non-occupé est la plus fo
rte pour un site déjà non-
occupé l’année précédente. Ensuite viennent les sites en
échec, et enfin les sites en succès. Cela traduit la
réutilisation privilégiée des sites en succès avant ceu
x qui étaient en échec (par fidélité des anciens
propriétaires ou recolonisation immédiate après un ab
andon ou mort des précédents propriétaires). Plus
les adultes sont parvenus à avancer dans le processus
de reproduction, plus le site a une forte probabilité
d’être productif l’année suivante.
Concernant la phénologie de la reproduction, l’effectif actif maximal lors d’une visite donnée (une
semaine selon le calendrier julien) n’atteint jamais le nom
bre total de sites actifs de la saison. La différence
a varié durant l’étude entre 10 et 56 sites actifs. Cela
représente de 8.4 à 26.7 % de
s effectifs totaux de sites
actifs annuels. Les effectifs actifs maximums observé
s une semaine donnée l’ont été de la semaine 11 à la
semaine 18 selon les années (calendrier ju
lien). Les effectifs actifs totaux ont été
approchés
selon les années,
entre les semaines 14 et 18.
En 2009, le baguage coloré des individus a comme
ncé. De 2009 à 2012, la probabilité de survie
estimée des individus marqués adultes a varié en
tre 0.69 (2011-2012) et 0.99 (2010-2011). Lors de leur
première année, la probabilité de su
rvie estimée des jeunes était inférieure : 0.29. Dès leur seconde année,
leur survie estimée est passée au-dessus de 0.90.
La production de poussins et la probabilité de su
rvie ont été utilisées pour construire un modèle
matriciel de projection de la population. Le taux de croissance populationnel obtenu avec le modèle
matriciel est légèrement inférieur à 1 (0.985), ce qui in
dique une population proche de la stabilité. Il ne
prend pas en compte l’incertitude sur les paramètres
démographiques. Ce taux de croissance est inférieur à
la valeur obtenue avec les effectifs de nids actifs
recensés sur Béniguet : 1.21 sur 21 ans (1992-2012). La
différence entre les deux valeurs de taux de croiss
ance peut être expliquée par trois hypothèses non-
exclusives. (i) Les hypothèses sur le
squelles repose le modèle matriciel
ne sont pas réalistes. (ii) Les
paramètres démographiques antérieurs
étaient bien supérieurs aux vale
urs récentes. (iii) Une immigration
substantielle est nécessaire pour expliquer l’augmentation observée du nombre de sites actifs.
Loading...